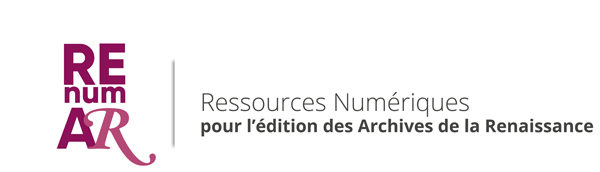Architecture nautique ligérienne : une première lecture technique d’un corpus documentaire tourangeau
Nevers, Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette, Retable : la vie de saint Jean-Baptiste, 4e quart 15e siècle. Copyright (@Déport de Société française d’archéologie, ministère de la Culture. Photographie de Lefèvre-Pontalis Eugène (1862-1923) Médiathèque de l’architecture et du patrimoine APLP006650, POP).
La vingtaine de documents relatifs à la construction de chalands de Loire, tirés des archives départementales d’Indre-et-Loire (séries 3 E8 et 3 E 9) et édités dans la base de données De minute en minute 2.0 (site RENUMAR, CESR, université de Tours), sont datés de 1485 à 1561. Reconnaissance de dette, quittance, vente de bois, marché de construction de chalands et de sentines : ce sont là autant de documents qui constituent une source d’un grand intérêt du point de vue de l’histoire des techniques de la construction navale fluviale. Dans le cadre de cette note, nous nous limiterons à l’évocation de deux aspects : ceux de la définition du projet architectural et de la chaîne opératoire.
Définition du projet architectural
Le marché de construction des 24 juillet et 18 août 1495, à travers l’énoncé détaillé des pièces composant la structure du chaland, de ses apparaux et de son gréement, fait apparaître en filigrane la façon dont l’esquisse architecturale de la coque semblerait être définie. Trois dimensions sont citées : la longueur totale de la coque (corps central et levées avant et arrière) de 13 toises et 4 pieds, la hauteur des flancs (dimension extérieure) proche du creux intérieur correspondant à 7 bords, la largeur du fond de 9 pieds donnée par les rables complétée par celle prise au niveau du haut des bords de 13,5 pieds correspondant à la largeur totale. Ces trois dimensions sembleraient être suffisantes pour permettre au charpentier d’avoir une représentation globale et finie de la coque du chaland à construire dans la mesure où toutes les autres composantes constitutives de la structure de la coque lui étaient quant à elles parfaitement connues. Les seules données dont il avait besoin pour répondre à la demande du commanditaire précisées dans le marché étaient les trois dimensions de base.
Le marché de construction d’un chaland daté du 4 septembre 1495, beaucoup plus concis que le précédent, réduit l’esquisse dimensionnelle de la coque à deux valeurs : celle de la longueur de 11 toises et demie considérée « en cousté » c’est-à-dire en élévation longitudinale (corps et levée), et la hauteur des flancs de 1 toise correspondant à 5 bords non compris le plat-bord (la « vizeure »). Ces deux dimensions interviennent dans la définition du projet architectural d’une façon similaire au cas précédent.
Dans ces deux documents à caractère mi-juridique et mi-technique dans lesquels un des interlocuteurs (marché de juillet/août 1495) est explicitement désigné comme « un charpentier de challans » et un autre (marché de septembre 1495) apparaît comme un présumé charpentier en raison des compétences indispensables pour faire un « patron »/gabarit de rable, le projet architectural dans sa perspective géométrique de forme apparaît défini dans le cas du marché le plus complet par trois dimensions : la longueur totale, la largeur inférieure sur le fond et celle supérieure au plat bord mettant en évidence la section ouverte de la coque, avec des flancs inclinés, et en dernier lieu la hauteur extérieure des flancs. Ces dimensions reposent à la fois sur des valeurs numériques en toises et pieds et sur des données architecturales en l’occurrence le nombre de bords par flanc. Cette mixité dimensionnelle associant l’immatériel (des chiffes) et le matériel (des pièces de charpente) semblerait révélatrice d’une pensée de la pratique technique où le poids du matériel et de l’objet en trois dimensions apparaît très présent. Une autre caractéristique importante est à souligner. Dans les deux marchés de construction considérés, aucune mention de la capacité de charge des bateaux devant être mis en chantier n’est faite. Pour le commanditaire comme pour le charpentier, l’esquisse dimensionnelle semblerait suffisante pour évaluer, d’une manière sans doute approximative, la capacité de charge du futur chaland. Les deux seules mentions d’une capacité de charge concernent une reconnaissance de dette du 20 octobre 1491 pour la vente d’une sentine et une vente d’un terrain pour construire une sentine en date du 25 avril 1495. Dans les deux cas, les intervenants ne sont pas des charpentiers de bateaux. Il est intéressant de noter à ce sujet que l’on retrouve une situation analogue en contexte maritime. dans les marchés de construction de navires de commerce et de pêche des XVe , XVIe et même XVIIe siècles. Le tonnage du futur navire n’est pas ou très rarement mentionné. Seules sont généralement citées les trois principales dimensions comparables en l’occurrence à celles de deux marchés de chalands ligériens – longueur de quille portant sur terre le plus fréquemment, largeur au maître-couple, creux – complétées par des dimensions secondaires comme l’élancement de l’étrave, la quête de l’étambot ... Le tonnage n’apparaît en règle générale que dans les marchés de réparations après donc un certain temps d’utilisation du bâtiment et d’appréciation par la pratique de sa capacité de charge.
Définition de la chaîne opératoire
Le marché de construction déjà cité (24 juillet et 18 août 1495) d’un chaland fournit un indice de la chaîne opératoire constructive à travers la procédure de paiement en deux temps principaux, avant et après la Saint Michel (le 29 septembre). Le document précise qu’à ce moment, « le fons [devra être] basti … ferrer, estancher et pallatrer ». Ce bref extrait du marché fait ainsi apparaître plusieurs importantes caractéristiques architecturales. La construction dans un premier temps du « fond » du chaland renvoie en toute logique à une architecture de principe « sur sole » qui se maintiendra jusqu’à la fin de l’existence des chalands de Loire. C’est bien en effet la sole intégralement assemblée, étanchéifiée et palâtrée qui constitue l’assise de la chaîne opératoire. Une indication d’importance concerne le temps de construction de la sole qui, entre la date de signature du marché et la Saint Michel, correspond à environ un mois et demi. Une fois la sole achevée la construction se poursuit après la Saint Michel sans que l’on puisse distinguer à l’analyse du document la chronologie des diverses séquences de la chaîne opératoire. On peut seulement supposer que la réalisation des levées avant et arrière intervient lors d’une des séquences constructives ultérieures en correspondance par conséquent avec des levées rapportées et assemblées à la sole et non ployées.
Le marché de vente de bois du 3 août 1494 fournit un indice supplémentaire du principe de construction « sur sole ». Il est demandé en effet à l’un des signataires de faire « ung patron » de rable aux dimensions précises de 9 pieds de long et de section un « dour en ung sens [sans doute en épaisseur] et ung demy pyé en l’autre [probablement en largeur] ». C’est le seul gabarit mentionné en relation en toute logique architecturale avec le rôle majeur tenu par la sole, avec ses rables, dans la structure d’ensemble du chaland. Cette mention d’un gabarit de rable est également très révélatrice de la pratique des charpentiers de bateaux. C’est l’objet/modèle à échelle 1/1 en trois dimensions qui sert de référence et de médiateur entre la séquence d’acquisition du matériau brut et sa transformation en pièce de charpente.
Conclusion
Ces quelques remarques n’ont eu pour ambition limitée que d’esquisser une première lecture technique de cet ensemble remarquable d’archives autour de deux sujets : ceux de la définition du projet architectural et de la chaîne opératoire. Tout l’enjeu, et le paradoxe, d’une telle approche a été de tenter de faire apparaître des processus techniques propres aux charpentiers de bateaux ligériens de la fin du Moyen Âge reposant sur une pensée de la pratique fondamentalement non écrite à travers des sources écrites. C’est une entreprise certes difficile mais passionnante pour un archéologue dont les sources premières que sont les épaves relèvent elles aussi de la seule pratique.
Eric Rieth
Directeur de recherche émérite au CNRS (LaMOP, UMR 8589) - Musée national de la marine - Membre de l’Académie de marine.