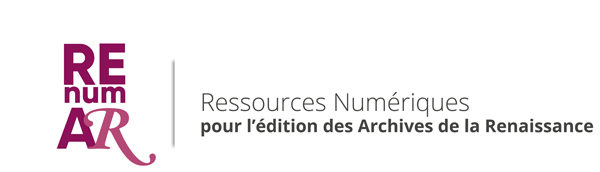Les entrées royales à Amboise (1461-1559)
Sujet privilégié des débats sur la puissance monarchique et son système communicationnel, les entrées royales font l’objet d’une documentation particulièrement riche1. Si les entrées de Tours et des villes du Centre-Ouest2 sont connues, la ville d’Amboise est restée relativement en dehors de ces études et ce malgré son statut de résidence royale et un corpus de sources d’une grande richesse. Une dizaine d’entrées est, en effet, renseignée dans les archives. Les mieux connues sont celles de Marguerite d’Autriche le 22 juin 14833, Anne de Bretagne le 2 décembre 15004, Éléonore d’Autriche le 5 septembre 15305, Henri II le 16 avril 15516 ou encore François II et Marie Stuart le 29 septembre 15597. Ces entrées sont documentées grâce aux registres de comptes de la ville conservés aux archives municipales d’Amboise (séries AA et CC).
Cérémonie par laquelle une ville reçoit les souverains et leur témoigne sa fidélité, l’entrée répond à un décorum relativement fixe. À Amboise, l’accueil des hôtes se fait en dehors de la ville. Accueillis par l’ensemble du corps de ville, ils sont placés sur une estrade et sous un dais. Aussi appelés poêles, ce sont des éléments incontournables et symboliques des entrées. Il s’agit de tentures, souvent en étoffes précieuses, qui étaient tendues sur un châssis soutenu par des montants. À Amboise, ils sont à franges réalisées en soie et damas de différentes couleurs. Ils étaient donc chamarrés et élaborés. En 1500, la ville confectionne deux dais, l’un pour la reine et l’autre pour le roi bien qu’il ne fit finalement jamais sans entrée dans la ville. Pour les confectionner, la ville achète 5 aunes et demie de damas rouge pour le dais du roi et 4 aunes et demie de damas blanc pour celui de la reine mais aussi 2 livres et demi de soie blanche et violette. Les deux poêles sont frangés de soie rouge et jaune et sont maintenus aux bâtons qui permettent de les porter par des liens blancs et rouges8. En 1551, les poêles allient de la soie tissée avec des fils d’or et d’argent pour les franges, ainsi que de la toile d’or et d’argent, du taffetas vert et blanc, du satin vert, du damas noir et blanc et du bougran vert et noir pour le corps de la tenture9. Le blanc semble être privilégié pour les dais des reines comme pour Anne de Bretagne en 1500 ou pour Éléonore d’Autriche10 30 ans plus tard. Ces éléments coûtent chers à la ville surtout quand, comme lorsqu’en 1559, la réalisation en est confiée à Claude Duluc, brodeur de Catherine de Médicis, qui les réalise en velours, soies, damas et étoffes d’or, et qu’ils sont attachés à six bâtons cerclés de fer par des rubans blancs et noirs. La ville débourse alors plus de 295 l.11, soit plus de la moitié du budget total de l’entrée, qui selon le compte qui lui est dédié atteignit les 535 l12. Cela témoigne du soin tout particulier qu’on leur accorde. Une fois sous leur dais, ils assistent alors au défilé urbain. Pour l’occasion, la ville fait réaliser des enseignes comme en 155113. Si l’entrée a lieu en soirée, le cortège urbain se dote de nombreuses torches comme en 149614. Treize sont mentionnées en plus des enseignes la même année. Les hôtes se voient ensuite remettre les clefs de la ville, nettoyées pour l’occasion15, au moment de franchir les remparts avant d’entamer sa procession dans la ville.
Processions et parcours des entrées
La localisation exacte de cet accueil « aux champs » – selon l’expression consacrée – nous est inconnue, ni même le parcours emprunté par la procession. Cependant, l’implantation de certains éléments de décor ou encore du nettoyage de certaines rues ou portes nous permet de déterminer certains lieux incontournables et des itinéraires. En 1461, lors de l’entrée de Charlotte de Savoie, la ville fait tendre un ciel au-dessus des rues du pont jusqu’au carroi – place centrale de la ville – et du carroi jusqu’à la porte du château16. Ce qui nous permet de dire que l’accueil a eu lieu au niveau des ponts au-delà de la Loire. Après avoir traversé le fleuve, le cortège prit la direction du carroi de la ville avant de se rendre au château. En 1559, on sait par où le roi doit arriver puisque l’on répare le « chemin tandans de la grosse tour du chastel d’Amboise a tirer a la forest par laquelle on doubloit le Roy arryver a ladicte ville »17, ce qui suppose un accueil au sud de la ville. En 1500, un mystère est joué à la tour des grands ponts18, un parquet est réalisé à Saint-Denis, un autre près de la porte Galaffre19, l’échafaud est installé au carroi20. Il semble qu’on longe également une partie des murailles de la ville21, ce qui laisserait à penser une sortie de l’enceinte de la cité. Le parcours le plus long et complexe semble être celui de 1551, puisque l’on a la présence d’éléments aux grands ponts de bois au niveau de la Loire22, au carroi23, à l’hôtel de ville24, au portail et à l’horloge25 et à Saint-Denis26. Les éléments mentionnés dans le cas de ces deux entrées permettent de retracer un itinéraire possible. L’accueil se faisait peut-être au niveau des ponts, que le cortège traversait ensuite pour rejoindre le carroi, avec sans doute un détour par l’hôtel de ville. La procession se dirigeait ensuite vers Saint-Denis en passant sous la tour de l’horloge. Après une cérémonie religieuse à l’église, le cortège longeait peut-être les murailles de la ville jusqu’à la porte Titery pour enfin rentrer dans l’enceinte fortifiée de la ville et se rendre au carroi puis au château.
Architectures et décors des fêtes
Pour apparaître sous son meilleur jour et révéler son caractère festif, la ville fait nettoyer les rues, curer les ponts et les portes et se pare d’un ensemble de décorations diverses.
Tout d’abord, la ville se couvre de végétation. La verdure est un lieu commun des décorations lors des entrées et des fêtes. Du lierre et du buis sont employés sur les chapeaux et l’arc de triomphe lors de l’entrée de Henri II27. Les rues sont jonchées de fleurs notamment de lys et de violettes28. La végétation, associée aux colonnes et arcs de triomphe, renvoie, surtout dans le cas de l’entrée d’Henri II, au thème du triomphe à l’antique.
La ville s’orne ensuite d’éléments armoriés représentant les armes des rois, reines ou personnages reçus. Lors de l’entrée de Marguerite d’Autriche en 1483, une bannière aux armes du Dauphin, soutenue par deux anges, est déployée29, ainsi que trois écussons or et azur30. Le premier figure les armes du roi, le deuxième les armes du dauphin et le dernier les armes de la dauphine. En référence au nom de la dauphine, des marguerites peintes sont disposées à l’échafaud. En 1500, pour honorer Anne de Bretagne et Louis XII, un porc-épic et une hermine sont réalisés auxquels s’ajoutent les éternelles bannières et écussons31. En 1497, les écussons sont situés aux portes du port sortant de la ville32. En 1530, ils sont sur le pourtour de l’échafaud installé à proximité de Saint-Denis33.
D’autres éléments sont aussi présents mais plus ponctuellement. Pour l’entrée de 1551, des effigies34, composées de colle et de farine de seigle, représentant des visages, sont confectionnées et assises aux quatre coins de la maison de ville sur des ais mais également aux échafauds35. Des figures – sans que l’on sache à quoi cela correspond vraiment – sont disposées sur des colonnes lors de la même entrée.
À tous ces éléments, s’ajoute l’utilisation de tapisseries et « faintes », c’est-à-dire des toiles peintes. Des feintes sont ainsi installées à l’échafaud en 148336. Il semble qu’on en ait également tendues le long des murailles en 1500 même si on ne retrouve pas le terme de feintes mais de draps tendus37 dans les sources. Des tapisseries sont employées en 1530. Provenant du château, elles sont mises à l’échafaud du carroi38. On en tend également au portail et à l’horloge en 155139. Dans les deux cas, leur sujet reste inconnu. Parfois, comme c’est le cas lors de l’entrée de 1496, le ciel du pavillon du carroi a pu être peint40. À cette occasion, il représente, sur un tissu de bougran bleu, trente épées peintes, auxquelles s’ajoute une grande épée dorée accompagnée d’un écriteau.
Hormis ces éléments de décoration, la ville s’emploie à mettre en œuvre des structures parfois complexes. Un arc de triomphe est notamment réalisé en 1551. Sa présence est d’autant plus intéressante qu’il s’agit du seul exemple d’arc confectionné pour une entrée à Amboise. Nous ne possédons que peu d’informations sur cet élément et encore moins de descriptions. Il semble cependant qu’il ait été en pierre41 ce qui est assez surprenant puisqu’il s’agit normalement de structures temporaires réalisées en bois.
Mais les structures les plus importantes et systématiques sont les échafauds. Ils sont placés à différents endroits de la cité. S’il s’agit la plupart du temps de simples planchers de bois, celui que l’on dispose au carroi de la ville est plus élaboré. Il se compose d’un mât placé au centre maintenu par un amas de terre ou de sable42. En 1500, on emploie à cette fin un arbre de la forêt d’Amboise43. Autour du mât est construit un plancher de bois qui forme ainsi une sorte d’estrade44. Le mât servait de support au pavillon – sorte de tente réalisée en tissu – qui est maintenu en place par un système de cordes tendues45. La mise en place des échafauds demande du temps. En 1483, il fallut neuf jours pour tendre le pavillon46. Leur installation requiert parfois un peu de bricolage. En 1500, on dut installer deux pierres longues de charpenterie sur les murs entre la chapelle et le tour du pont pour tendre les cordes47. En 1500, on a recours à six manœuvres pendant trois jours pour installer le mât et réaliser le parquet qui l’entoure48 et encore six jours supplémentaires à quatre autres hommes pour tendre les cordes49. Le pavillon est composé de draps cousus ensemble. Pour l’entrée de 1500, nous avons la mention des noms de 24 femmes qui sont rassemblées pendant trois jours dans une salle de l’hôtel de ville pour coudre les draps qui le composent50. Elles travaillent de nuit, à la lueur des bougies51. Les draps, nappes et autres linges utilisés sont d’ailleurs empruntés aux habitants de la ville qui sont indemnisés si les linges sont abîmés durant l’entrée ou si le linge rendu ne correspond pas à celui emprunté52.
Des représentations théâtrales : les mystères
Sur ces échafauds, la ville donne à voir à la population et aux rois des représentations théâtrales. Ces mystères, selon l’expression consacrée, sont des saynètes, la plupart du temps muettes, qui s’animent au passage du roi. Sortes de « tableaux vivants », ils mettent en scène des personnages costumés dans un décor architectural et sont, bien souvent, accompagnés d’enfants de chœur53, musiciens et danseurs. Amboise a très tôt développé un goût prononcé pour ce genre de représentation et elle joue plusieurs mystères au cours de la Renaissance que ce soit dans le cadre des entrées ou en dehors. Ces pièces peuvent avoir un sujet profane, souvent puisé dans la mythologie antique, soit un sujet religieux relatant la vie d’un saint ou un épisode de la Bible. Lors des entrées royales, la ville a bien souvent privilégié les sujets mythologiques ou antiques même si elle a pu donner à d’autres occasions des mystères religieux54. Le mystère du jugement de Pâris est joué le 22 juin 1483. Il met en scène trois déesses et de deux hommes sauvages55. Si l’on se réfère à l’épisode mythologique dont il est question, les trois déesses sont Héra, Athéna et Aphrodite et l’un des deux hommes est sûrement Paris de Troie56. L’une des déesses est vêtue d’une robe de taffetas rouge, une autre de bougran bleu57 et la dernière d’une robe en toile de lin peinte en vert58.
Quelques années plus tard, on choisit de représenter le mystère de Jules César. Il devait être joué à la tour des grands ponts lors de l’entrée de Louis XII le 2 décembre 1500 mais la représentation n’eut jamais lieu, le roi ayant décidé de ne pas faire son entrée ce jour-là59. Il fut annulé malgré la présence de la reine Anne de Bretagne, qui elle fit son entrée. Il semble donc que le mystère ait été véritablement à destination de Louis XII. On sait peu de choses de ce mystère mais peut-être s’agissait-il ici de rappeler les victoires italiennes de Louis XII, d’autant plus que le thème du triomphe est sous-jacent au mystère. On réalise, en effet, trois couronnes et des chapeaux de triomphe pour l’occasion et des éléments d’armures sont acheminés depuis le château60. On avait peut-être ici une référence aux vertus guerrières et aux victoires de Jules César et par analogie à celles du roi. De plus, le sujet n’est pas vraiment surprenant si l’on prend en compte le fait que Jules César était considéré comme le fondateur de la ville d’Amboise.
Un autre mystère, assez énigmatique, fut joué le 16 avril 1551. Selon l’un des comptes dédiés à l’entrée, il y avait sur scène quatre sibylles qui jouaient sur la colonne au carroi61. Habillées de satin noir doublé de taffetas blanc, notamment au niveau des manches62, elles étaient revêtues de colliers et de bottines de cuir blanc63. Les personnages mis en scène sont Haine64 & le Bontemps65. Une robe de soie, une autre de taffetas rouge et jaune66 et des chausses incarnates67 sont réalisées pour ces personnages. Si le personnage du Bontemps est un lieu commun des représentations théâtrales de cette période, le personnage de la Haine est assez inédit. Le Bontemps est généralement une allégorie de la fête et est la plupart du temps associé au personnage de Faute d’argent. Quant aux sibylles, elles sont, dans la mythologie grecque, des femmes à qui on attribuait un don de voyance. Cependant, à la Renaissance, elles sont de plus en plus associées aux prophètes dont les paroles annonçaient le messie. Il est possible que le sujet de ce mystère ait allié le profane et le sacré.
Le sujet d’un mystère n’est jamais anodin. Choix délibéré pour faire passer un message, il se rapproche d’un miroir du prince. À l’origine, le miroir du prince est un genre littéraire destiné aux princes et s’apparentant à des recueils de préceptes moraux censés être suivis par les princes afin d’assurer un bon gouvernement. En identifiant la figure royale à des personnages illustres, qu’ils soient antiques ou bibliques, la ville fait non seulement honneur au roi mais elle assimile également les qualités de ce personnage mythique au roi. Le caractère éducatif des mystères se manifeste particulièrement bien en 1483, où les archives attestent de la présence sur la scène d’un homme d’armes chargé de faire « la remonstrance de Paris avecques lesdictes déesses »68. La scène du jugement a ici vocation à tirer un enseignement par les reproches faits au personnage de Pâris dont les choix malheureux ont entraîné sa perte et celle de son royaume. Des vertus moralisatrices transparaissent et s’adressent directement au souverain qui sait parfaitement décrypter le message sous-jacent que ce dernier soit le rappel des qualités dont il doit faire preuve ou des éléments nécessaires au bon gouvernement du royaume.
Banquets et présents
Mais les entrées ne visent pas uniquement à satisfaire la vue par les décors, les mystères et les feux d’artifice, l’ouïe par les chants et la musique, l’odorat par les fleurs et la verdure. La ville n’oublie pas pour autant l’estomac de ses convives et de ses habitants. À proximité des échafauds, sont systématiquement installées des fontaines. Mises à la disposition de tous, elles permettaient de délivrer du vin. La plus élaborée est celle de 150069. À cette fin, sont réalisés un porc-épic et une hermine qui sont mis sur deux gros piliers de bois peint placés au carroi. Les piliers sont recouverts de chapiteau et des lys placés au milieu et au-dessus du porc-épic et de l’hermine70. Au sein de cette installation, est intégré un système de tuyaux de plomb71 qui délivre du vin blanc et du vin rouge. En plus de ces fontaines, des tables sont disposées à plusieurs endroits de la ville (au carroi ou à Saint-Denis notamment). On sait en partie quelles denrées pouvaient être mises à disposition lors des entrées. On commande du vin clairet et de cinq douzaines de pains pour l’entrée de 150072. Deux livres de dragées perlés, des mets à base de cannelle ou encore des amandes confites sont distribués lors des feux de joie donnés à l’occasion de la trêve avec l’Angleterre en octobre 149673. Déjà en 1483, l’achat de « sucre bulle »74 à destination des pâtissiers indique la confection de mets sucrés. On y sert également de l’hypocras, du vouvray et du fromage75.
On retrouve le vin parmi les présents offerts lors des entrées. Les comptes de l’entrée d’Henri II et de Catherine de Médicis en 1551 nous donnent une idée assez précise des types de cadeaux que la ville d’Amboise pouvait offrir. Au vin s’ajoutent des fruits et légumes. Ce type de présents débute en amont de l’entrée. Pour l’entrée de 1551, ils commencent au mois de juin 1550. Le Cardinal d’Armagnac reçoit des abricots, des poires, un bouquet d’œillets, ainsi que des cerises griottes et du vin clairet76. Le roi et la reine se voient offrir des poires et des pommes77. À d’autres moments, il a pu s’agir d’artichauts, de cerises bigarreaux ou encore de fraises78, parfois même de confitures. Ces présents, qu’importe leur nature, ne sont pas uniquement offerts au roi et à la famille royale pour obtenir leurs grâces. Ils s’adressent aussi à des personnages haut placés susceptibles de jouer les intercesseurs et d’interférer en faveur de la ville auprès du roi.
Lors des entrées, la ville modèle et affirme son identité en prenant soin d’apparaître sous son meilleur jour et en ne dévoilant au roi que les éléments voulus et cela lui coûte cher. L’entrée de Louis XII et d’Anne de Bretagne de 1500 amène la ville à débourser 133 l. 4 s. 8 d79. Onze ans plus tard, l’entrée de Henri II et de Catherine de Médicis augmente considérablement le budget puisque l’on passe à 917 l. 14 s. 9 d. si on additionne les deux comptes qui lui sont dédiés80. L’entrée de François II et de Marie Stuart en 1559 observe un recul des dépenses à 535 l. 2 s. 4 d.t81. Les entrées pèsent lourd dans les budgets annuels de la ville. Cependant, les bénéfices qu’en tire la ville valent bien le sacrifice consenti. La ville démontre au roi qu’elle est capable d’assurer sa propre protection notamment en disposant son artillerie sur les remparts, mais aussi d’offrir un spectacle grandiose à son roi tout en lui délivrant implicitement un certain nombre de messages notamment à travers les mystères. La ville sait pertinemment qu’elle a tout intérêt à offrir à son roi un spectacle susceptible de lui plaire, ses privilèges et sa qualité de résidence royale en dépendent. Par la solidarité et l’implication de chacun, les entrées tendent, de plus, à la consolidation d’un sentiment d’appartenance à une communauté qui se cristallise autour du roi. Elles servent une seule et même entité qu’est la figure royale, dont la propagande se développe pleinement dans l’iconographie et le programme des célébrations. C’est à travers ces éléments que se dévoile une partie des liens qui lient la ville à son souverain car les entrées sont fondamentalement des dialogues tacites qui passent davantage par le geste que la parole.
Lea Dupuis
Pour une synthèse historiographique, voir Alazard, F., et Mellet, P.-A., “De la propagande à l’obéissance, du dialogue à la domination : les enjeux de pouvoir dans les entrées solennelles”, dans Rivaud, D., Entrées épiscopales, royales et princières dans les villes du Centre-ouest du royaume de France (XIVe-XVIe siècles), Genève, Droz, 2012, p. 9-22, à paraître.
Voir Rivaud, D., Entrées épiscopales, royales et princières dans les villes du Centre-Ouest de la France XIVe-XVIe siècles, Genève, Droz, 2013 et l’article du même auteur publié sur le site Renumar, sur les entrées solennelles de la Renaissance à Tours : http://renumar.univ-tours.fr/publication/les-entrees-solennelles-a-tours/
AC, AA 130.
AC, AA 131.
AC, CC 131.
AC, AA 132 et 133.
AC, AA 134.
AC, AA 131, fo1.
AC, AA 132, fo35vo.
AC, CC 131 « Item du XXXe jour dudict moys pour l’achapt fait par Jacques Petit esleu par maistre Florens Anyerart par eux a Tours de dix aulnes damas blanc pour servir a faire le paelle pour la reception de la Royne a son entree en ceste ville a raison de soixante cinq solz l’aune pour ce XXXII livres X solz tournoys. »
AC, AA 134, fo1vo : « Et premierement a este fourny et avance par noble homme maistre Helye de Hodeau notaire et secretaire du roy contrerolleur general de la maison de la royne mere du roy et maire d’Amboyse a Claude Duluc brodeur de ladicte royne mere du roy pour les daists faicts par ledict Claude Duluc lesquelz ont servy pour l’entree audict sieur roy et royne la somme de deux cens quatre vingtz quinze livres dix sept solz huict deniers tournoys pour les vellours, soyes, damas et estoffes tant d’or que d’autres choses contenus es parties dudict Duluc brodeur susdict baillez audict de Hodeau maire de ladicte ville et par luy veuz et arrestez a ladicte somme de IIc IIIIxx XV livres XVII solz VIII deniers. »
AC, AA 134, fo6vo.
AC, AA 132, fo47ro : « A Jehan Brunet painctre pour par luy avoir painct et fourny de toutes painctures d’or et d’argent l’enseigne faict faire par la ville pour estre pointer par le porte enseigne des gens de pied ordonnez pour aller au davant du roy et royne [fo 47 vo] la somme de cent solz tournoys comme appert par quictance dactee du vingt troysme jour de mars dernier passé pource cy C s.t.»
AC, CC 111, fo33vo, « A Huguet le Barrier, Gervaise Loriot, Guille Gillier, Jehan Gruel et Loys Brisson appothicaires et ciergiers VIII livres savoir est audit Lebarrier LXXVII solz VI deniers cest assavoir XLII solz VI deniers pour XVIII torches aupris de II solz VI deniers piece et XXXV solz pour sept autres torches de chacune une livre aupris de V solz piece audit Loriot XXII solz VI deniers pour six torches poissant chacun troys quarterons cire qui est aupris de III solz IX deniers piece, audit Gillier XX solz pour quatre torches de chacune une livre aupris de V solz piece, audit Gruel XXV solz pour cinq torches de chacune une livre cire audit pris de V solz piece et audit Brisson XV solz pour quatre torches de chacune troys quarterons cire qui est aupris de III solz IX deniers piece. Lesdites torches par eulx baillees et livrees la vigille de toussains l’an de ce compte pour aler au davant de la Royne qui vint ledit jour devers le soir de Tours ou chastel dudit Amboise comme appert par mandement et quictance cy rendus pource VIII livres. »
AC, AA 132, fo43ro.
AC, BB1, fo9vo, 26 août 1461 : « Traicter de l’entree et deu que on fera a la joyeusevenue de la royane en ceste ville, qui devoit venir en ceste ville, et decida que la ville fust tendue depuis le pont jusques carroir et d’icelui carroir jusques a la porte du chasteau et que joyeulx esbattements se facent comme anges, volutes et autres belles choses pour ladicte venue. »
AC, AA 134, fo3vo.
AC, AA 132, fo53vo.
AC, AA 131, fo6ro.
AC, AA 131, fo3ro.
AC, AA 131, fo8vo et 9ro : « A Martin Menuau sarreurier pour douze pates de fer par luy baillees et atachees au portal de la masse pres Bougran pour faire tenir des lymandes au long de la muraille pour tandre des cordes a mectre des draps dessus au pris de X d. piece. A esté paié tant pource que pour avoir fourny de plastre emploié a ce faire X s. »
AC, AA 132, fo53vo : « Plus paye a Guillemyn de la Rue pour cinq toises demye (de = interligne) boys carré qui a servy a faire ung chevallet et paulx qui ont esté mis au grans ponts de boys a raison de dix solz tournoys pour toise pource cy LV s. t. »
AA, AA 132, fo61vo.
AC, AA 133, fo37ro.
AC, AA 133, fo35ro.
AC, AA 132, fo47vo.
AC, AA 132, fo29vo et 30ro.
AC, AA 130, fo27ro.
AC, AA 130, fo28vo, « En laquelle bannyere il fist les armes de monseigneur le daulphin à deux anges qui les soustenoient de chacun couste dicelle bannyere. »
AC, AA 130, fo28vo : « pour trois escussons de fin or et azur qu’il fift à icelle l’un aux armes du Roy ung aux armes de monseigneur le daulphin et l’autre aux armes de madicte dame la daulphine. »
AC, AA 131, fo2vo.
AC, CC 112, fo29ro.
AC, CC 131.
AC, AA 133, fo12ro.
AC, AA 134, fo36vo et 37ro.
AC, AA 130, fo27ro : « […]la somme de XX s. t. pour deux journees qu’il a vacqué en ceste ville d’Amboise a appareiller les faintes mises a l’eschaffault fait a l’entour dudit pavillon. »
AC, AA 131, fo8vo et 9ro : « A Martin Menuau sarreurier pour douze pates de fer par luy baillees et atachees au portal de la masse pres Bougran pour faire tenir des lymandes au long de la muraille pour tandre des cordes a mectre des draps dessus au pris de X d. piece. A esté paié tant pource que pour avoir fourny de plastre emploié a ce faire X s. »
AC, CC 131 : « Cedict jour XII deniers a ung homme pour avoir aporte de la tappicerie du chasteau pour l’eschaffault pource XII deniers. »
AC, AA 133, fo35ro.
AC, CC 111, fo28ro.
AC, AA 132, fo49vo, « Plus a cinq hommes qui ont amené et pourté toutes les pierres du portail de triumphe et pour avoir fait acoustees les charrouncaulx pour faire amener les grosses pierres oudit portail faict aux hommes que au charron la somme de vingt solz tournoys cy XX solz tournoys. »
AC, AA 132, fo48vo.
AC, AA 131, fo2vo : « A Jehan Lepaige charretier pour ses peine et salaire d’avoir esté querir en deux charretes acoublees ensemble en la forest dudit Amboise ung grant arbre dont a esté fait ung mast mis on carroue de ladicte ville sur lequel a esté fait ung grant pavillon qui couvroit tout ledit carroue durant ladicte entree. A esté paié la somme de X s. t. pource X s. »
AC, AA 132, fo54ro.
AC, AA 130, fo31.
AC, AA 131, fo3 et 4.
AC, AA 131, fo2vo : « A Roulin Hainart menusier a esté paié pour ledit Moreau la somme de XXVII s. VI d. pour avoir fait deux chasses pour faire lesdites deux poisles et huit bastons pour porter et aussi pour sept toises et demye de repartaige par luy baillé qui ont esté mises au moulin de l’aumosne pour servir a tendre les cordes deux toises et demye de seaige pour servir aux chaffault et pour avoir fait deux fenestres bastardes aux lucanes des goutieres de la maison de la ville ainsi que tout peut apparoir par quictance pource XXVII s. VI d. »
AC, AA 131, fo3ro.
AC, AA 131, fo3vo.
AC, AA 131, fo7ro : « A Henryet Gillebert tavernier pour despense faicte en lostel de ladicte ville pour les femmes et filles qui ont couru lesditz draps dudit pavillon […]. »
AC, AA 131, fo5ro : « A Jehan Gaudillon pour vingt six livres et demye chandelle de suif par luy baillee despensé a servir aux femmes qui ont besoigné de nuyt a faire ledit pavillon. Aux paintres et autres choses pour le fait de ladicte entree au pris de XII d. la livre pource XXVI s. VI d. »
AC, AA 131, fo10ro : « A la femme maistre Guille Demons clerc d’offices de madame la duchesse de Berry, à la vesve feu Pierre Bonoreau et a la femme Rene Fyot pour le desdommaigement de chacun six draps de ling et mes linge par elles baillez pour faire le pavillon du carroie a ladicte entrée dont les aucuns desditz draps ont este rompuz et descirez a este paie pource la somme de LXXV solz tournois qui est a chacune d’elles XXV solz tournois pource LXXV solz. »
AC, AA 130, fo27ro.
Le mystère de Saint-Denis est ainsi mis en scène en 1490 et des mystères de la Passion sont représentés à plusieurs reprises entre 1494 et 1510. Joué à quatre reprises sur cette période, il atteint une certaine renommée, au point que Louis d’Orléans demande à la ville une copie du livret du mystère. Mais le mieux renseigné est le mystère de la Nativité. Il est joué dans la cour du château la nuit de Noël 1497 devant le roi et la reine.
AC, AA 130, fo28ro.
Lors du mariage de Thétis et Pelée, les parents d’Achille, tous les dieux et déesses furent conviés à l’exception d’Éris, la déesse de la discorde. Pour se venger, Éris déposa sur une table du banquet une pomme avec l’inscription « À la plus belle ». C’est le fameux épisode de la pomme de discorde. Sitôt, trois déesses revendiquèrent la pomme, Héra, Athéna et Aphrodite. Refusant de désigner l’une des trois, Zeus fit envoyer Hermès afin d’aller quérir le plus beau des hommes pour départager les déesses, Pâris fut ainsi désigner. Les déesses tentèrent de soudoyer le jeune en homme en lui promettant pour Héra, un territoire en Orient, pour Athéna, la victoire et la gloire guerrière et pour Aphrodite, la plus belle femme du monde. Ne se laissant pas séduire, Pâris fit poser les trois femmes et choisit la déesse de la beauté. En récompense, Aphrodite lui offrit la plus belle femme, Hélène de Sparte, femme de Ménélas. Pâris, par son choix, s’attira les foudres des deux autres déesses et causa la chute de son royaume à la suite de la guerre de Troie.
AC, AA 130, fo30vo : « pour quatre aulnes de bougran bleu […] l’autre partie dicellui bougran fut mise a faire labit de l’une des filles qui estoient ou chaffault […] pour deux aulnes ung tiers bougran rouge mis a faire l’abit de l’une des aultres filles qui estoit oudit eschaffault […] »
AC, AA 130, fo51ro : « A ladicte nepveue VI soulz V deniers pour avoir taint en vert la toille de lin achaptee de ladicte Gerbaulde pour faire abbit à une des déesses [...]. »
AC, AA 131, fo6ro : « A luy pour troys grans panoiz esquelz a une toise de boys faiz pour le mistere de Julyus Cesar que on voulut jouer a la tour des grans ponts a la venue du Roy ce que n’a este fait parce que ledit sire ne fist aucune entree a este paie pource. »
AC, AA 131, fo8ro : « Pour avoir fait rendre et porter on chastel d’Amboise six curaces de haunoys jambies garde braz et salades qui avoient esté emprunctees pour devoir jouez a ladicte entree le mistere de Juluis Cesar a esté paié six maneuvres qui les ont porter a chacun d’eulx VI deniers pource III solz. »
AC, AA 132, fo28ro.
AC, AA 132, fo28ro.
AC, AA 132, fo61ro.
AC, CC 131
AC, CC 131
AC, CC 131
AC, CC 131 « Item pour demye aulne doubleuse incarnat pour doublez les chausses dudict Bontemps pour ce VI solz tournoys.
AC, AA 130, fo51vo.
AC, AA 131, fo5ro.
AC, AA 131, fo5vo
AC, AA 131, fo5ro : « A Loys Constely pintier pour la façon de deux tuaulx de plomb par luy baillé qui ont servy à faire gecter le vin par lesditz porc espy et hermyne à l’entrée de la Royne […] »
AC, AA 131, fo7vo.
AC, CC 112, fo30vo : « A Laurens Chaillon, appothicaire, LXXI solz VIII deniers savoir XV solz pour deux livres dragee perlee, canelle et admendes confictes qui furent donnees on moys d’octobre l’an de ce compte quant on fist les feuz en ceste ville pour les bonnes nouvelles qui vindrent d’Angleterre. »
AC, AA 130, fo30ro.
AC, AA 130, fo33ro.
AC, AA 134, fo39ro et vo.
AC, AA 134, fo43ro.
AC, AA 134, fo44vo.
AC, AA 131, fo10vo : « Nous commissaires et estenz cy devant nomez certiffions a tous qu’il appartiendra les parties et choses dessusdictes estre vrayes et avoir esté faictes par notre commandement par Estienne Moreau commis […] en la manière que cy dessus est declairé montant et faisant ensemble la somme de VIxx XIII livres IIII solz VIII deniers […]. »
704 l. 7 s. 7 d.t. pour le premier compte (AC, AA 133) et 213 l. 7 s. 5 d.t. pour le second compte (AC, AA 134 fo45ro).
AC, AA 134, fo6vo, « Somme totalle cinq cenq trente cinq livres deux solz quatre deniers tournoys. »